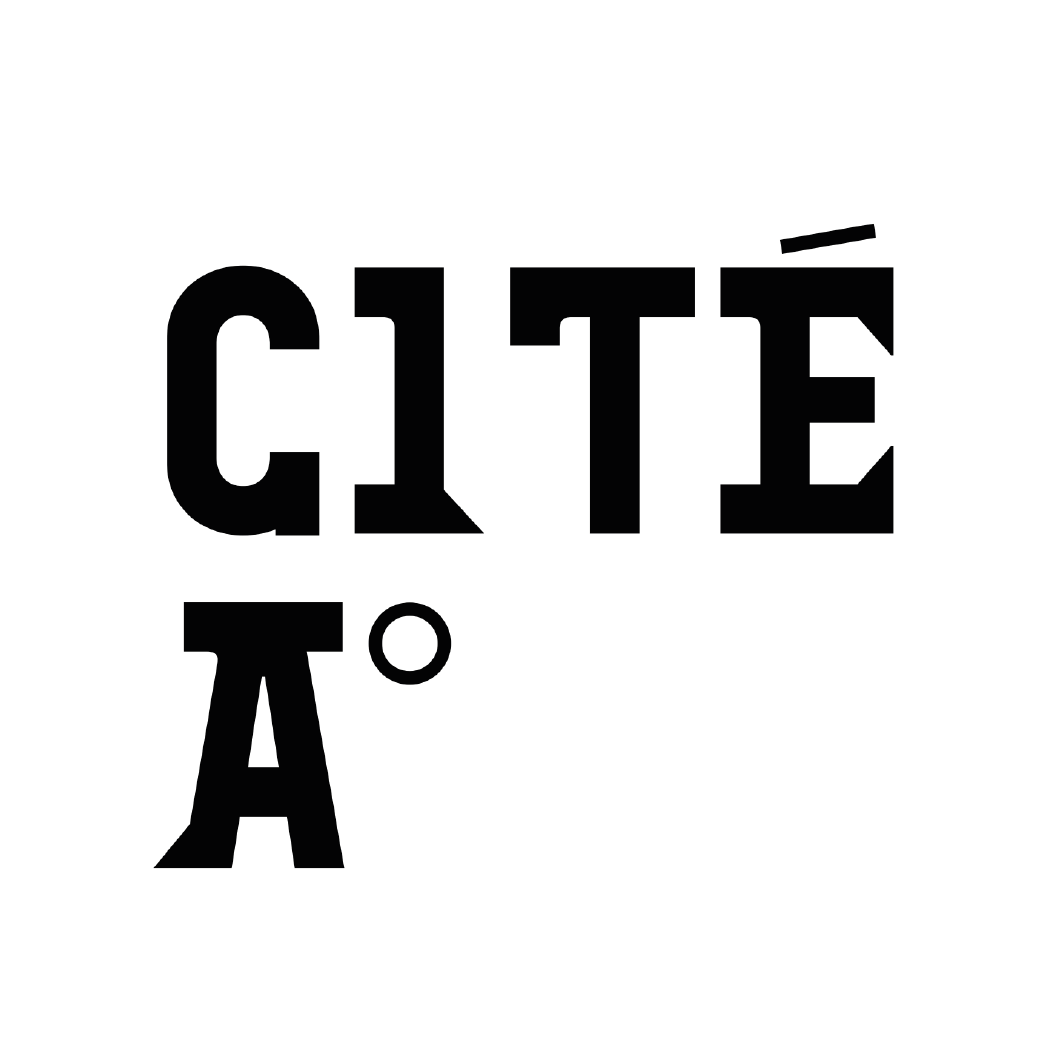Les semaines qui viennent de s’écouler ont été riches d’événements ultra consommateurs en énergie. Aujourd’hui, nous allons décrypter les enjeux énergétiques et socio-politiques embarqués par le vol de 11 minutes de Katy Perry dans l’espace et la tendance des starter packs générés par IA. Au-delà du rappel des consommations énergétiques effarantes que ces deux actions ont engendrées, c’est surtout de logiques de priorisation et de confrontation d’imaginaires que nous allons discuter.
Une chronique de Virginie Chaput (laboratoire ELICO).
Vous n’avez pas pu le rater, la semaine dernière, la pop star Katy Perry s’est envolée direction l’espace, aux côtés de 4 autres femmes, dans une fusée affrétée par Jeff Bezos. Il paraît qu’elle aurait chanté What a wonderful world en regardant par le hublot: cocasse après avoir dépensé autant pour le quitter 11 minutes, mais soit. Rapidement, rappelons que l’industrie spatiale, bien que très utile pour la recherche, est extrêmement polluante et énergivore. En décollant, les fusées émettent énormément de vapeur d’eau et de particules de suies. En ce qui concerne la vapeur d’eau, plus elle est produite à de hautes altitudes, plus elle deviendra un gaz à effets de serre redoutable. La suie, de son côté, participe à réchauffer l’atmosphère en absorbant les rayonnements lumineux: plus elle est présente dans l’atmosphère en grande quantité, plus elle y fera stagner de la chaleur par ce phénomène de captation. Une technologie aussi sensible pour le climat ne peut décemment pas faire l’objet d’une campagne de publicité pour en faire le dernier vaisseau touristique à la mode.
Mais au-delà de la promotion du tourisme spatial, c’est tout un imaginaire autour de la conquête spatiale qui est véhiculée par Katy Perry, Jeff Bezos et compagnie.
L’espace et le spatial, c’est d’abord le déchaînement de la puissance technologique humaine et de sa capacité à s’extraire de sa condition animale, à se défaire jusqu’à de son espace naturel, trop étriqué et pas foutu de rester debout face à la coquette tendance humaine de le trouer de tous les côtés. L’imaginaire spatial rejoint ainsi celui des conquêtes, lit du penchant colonisateur comme marque de fabrique d’une supposée puissance. Ce primo récit justifiant l’exploration spatiale s’adosse, pour le chercheur Irénée Régnauld, à la croyance qui voudrait qu’il soit dans la nature humaine de sans cesse viser la découverte de nouveaux territoires: la terre est cartographiée dans ses moindres recoins, alors nous reste l’espace pour nous occuper pour le million d’années à venir. Cet imaginaire de l’espace comme immensité à conquérir en fait la scène d’un futur ultra technologisé, considéré comme un véritable hold-up sur nos utopies selon Alice Carabédian. Ces histoires nous offrent en effet pour seul horizon Mars en terre d’exode pour humains fortunés, en mal d’eau: ici, les autres planètes du système solaire seraient nos uniques terres d’asile, tant pis pour celle-ci, il va falloir accepter et continuer tous azimuts d’en ruiner les restes, si on veut avoir la chance de partir vers d’autres oasis. Avec un peu de créativité, on aura bien des jolies combinaisons pour faire avaler la pilule. Pour Ségolène Guinard, en filigrane, se dessine là en réalité un aveu de la catastrophe écologique en cours et à venir, avec une pichenette d’intensité supplémentaire. C’est que la conscience de la fragilité de notre climat terrestre et de la nécessité de le comprendre pour être en mesure de le protéger sont intimement liés aux progrès spatiaux. En effet, les technologies spatiales permettent de mesurer les variables climatiques et d’ainsi assurer le suivi du dérèglement climatique, connaissance indispensable pour pouvoir se préparer et, qui sait, changer.
Katy Perry a symboliquement rejoué cette tension non intuitive en embrassant “mother earth” comme certains aiment à l’appeler alors qu’elle venait participer à un cramage en bonne et due forme d’une paire de tonnes de gaz à effets de serre, ennemis insidieux de l’équilibre planétaire.
Enfin, une poignée d’humains seulement a pu aller dans l’espace. S’il est des voyages qui forgent les légendes, celui-là en est un. Histoire de petits pas et de géant, il n’aura fallu que d’une démarche mal assurée sur un sol qu’on avait jamais vu de par nos contrées, pour fournir matière à rêver à des générations entières d’enfants. Alors, pour plus tard, ça sera ça ou bien pompier. Le ton est ici sarcastique, mais évidemment qu’il y a de quoi rêver à en voir certains d’entre nous pouvoir voir de leurs yeux la terre vu non pas du ciel, trop banal, mais de la stratosphère. Seulement, aujourd’hui, on est grands et il faut absolument et irrémédiablement que l’exception reste la règle. Katy Perry, de son côté, a voulu déjouer la grammaire et a joué l’astronaute : c’est un rêve de gosse qui est ici offert aux ultra-riches, au nez et à la barbe de notre avenir à tous. La possible réalisation de ce fantasme fortement partagé nous contraint de ruiner les rêves des enfants. L’espace doit, si on veut garantir nos possibilités de survie sur terre, rester un songe. Et, entre nous soit dit, est-ce vraiment grave ? Est-ce que renoncer à 10 minutes tout là-haut et garder le plaisir de jouer à l’astronaute sur terre, peut être réellement considéré comme un sacrifice ?
Autre technique, autre scandale, autre récit, autre mythe. Depuis quelques années, on voit la performance et l’usage des technologies d’intelligence artificielle exploser. Tout a commencé par les expériences de connaissances lointaines qui nous racontaient leurs discussions étonnantes avec un nouveau bot: nous les avons écoutés d’une oreille distraite nous promettre une révolution, et puis nous sommes retournés à ce bon vieux google. Et puis, il y a eu nos amis qui nous ont avoué ne plus pouvoir se passer de Chat GPT pour écrire un mail. Et puis notre oncle, qui ne se souvient même plus comment il faisait son métier de comptable avant l’IA. On a entendu des artistes frémir de perdre le peu de cachets qu’ils parvenaient déjà difficilement à arracher, mais on ne voyait pas le danger: les premières images générées par IA étaient trop bizarres pour plaire, rien à craindre. Et un jour, on a ouvert Instagram pour y découvrir avec étonnement un uniformisme encore jamais atteint: là, sous nos yeux, amis et familles, tout le monde au même régime, empaqueté derrière un simulacre de protection plastique et encadré de deux trois items, histoires de gagner en saveur. La révolution était là, un peu décevante, mais bien là: l’IA était devenue tendance Instagram. Pour l’heure donc, pas de solution miracle au dérèglement climatique ou au cancer sortie de la caboche de chat GPT mais un raz de marée de starter pack, mot catchy utilisé pour désigner une image générée par IA représentant une personne entourée de ses objets préférés, le tout encadré de plastique pour simuler une boîte de jouet. En une semaine, chat GPT a traité 700 millions de demandes. De nombreuses personnalités se sont prêtées au jeu, avant de revenir sur cette activité et de nous mettre en garde sur la catastrophe écologique que représente cette tendance. S’il est bien difficile de résister à l’IA, son usage ne peut se faire de manière anodine puisque n’étant pas sans conséquence. Aussi, de plus en plus, les critiques sur la démocratisation de l’IA se multiplient et, comme pour le tourisme spatial, se font entendre.
Selon Sasha Luccioni, spécialiste de l’impact environnemental de l’IA, générer un starter pack demande autant d’énergie que la recharge complète d’un téléphone. Pour autant, la fièvre est lancée et les prévisions ne sont pas bonnes pour la planète. D’après l’agence internationale de l’énergie, les serveurs et autres centres de stockage et traitement de données vont voir leurs besoins énergétiques augmenter, et ce, notamment en raison d’un recours grandissant à l’IA dans une multitude d’activités, y compris pour le divertissement personnel. Plusieurs problèmes se donnent ainsi à voir. Notons d’abord que l’énergie n’est pas produite de façon décarbonée sur toute la planète et que même lorsque c’est le cas, il semble opportun d’interroger ce nouveau besoin à l’aune de l’urgence environnementale, de la raréfaction des ressources et de l’explosion des prix de l’énergie. Comment décemment parler de sobriété énergétique sans questionner notre acceptation collective de consommer autant d’eau et d’électricité pour une image publiée dans une story visible 24h ? Avant même de discuter de normes de température dans les logements, il s’agirait de repenser urgemment nos priorités: l’énergie abondante ne peut plus être et chaque kilowattheure produit génère des externalités négatives pour le climat. Il est donc essentiel de flécher les usages de ces précieuses unités énergétiques. Consommer collectivement l’IA de cette manière, sans en mesurer l’impact social et environnemental, revient à laisser le moteur de nos voitures tourner alors que l’on va faire des courses. Il est l’heure de prioriser pour réduire. L’IA générative ne répond pas à un besoin urgent. Faire fabriquer des millions de fois des images pour symboliser nos personnalités est une gourmandise, mais pas un besoin et, croyez-moi, je suis navrée de jouer les rabat-joie.
Pour la chercheuse en informatique Florence Maraninchi, le déploiement de l’IA n’est pas une bonne nouvelle. Elle interroge ainsi le rapport que l’on entretient avec la technologie, mais aussi avec nous-mêmes: qu’est-ce qui fait que l’on puisse faire confiance aussi facilement au savoir d’une intelligence artificielle, et même la considérer comme plus efficace que nous même ? Elle rappelle que certes l’IA va plus vite pour effectuer un certain nombre de tâches, mais qu’elle passe aussi à côté de quelques subtilités: la communication informelle et non verbale qui participe à donner sens à un compte-rendu de réunion par exemple, qui nous prendra à nous pauvres humains une demi-heure à pondre, mais qui se rapprochera certainement de toute la nuance du réel. À nouveau, il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain: l’IA peut être utile dans bien des cas, mais il semble tout à fait à propos d’interroger l’immense place qu’on lui laisse sans résistance aucune.
Enfin, la chercheuse nous rappelle dans son billet grinçant que les IA vont certes nous faire gagner du temps de travail, mais sûrement pas pour nous permettre d’aller flâner à la plage. Non, non, non: nous aurons du temps libéré pour être encore plus productif. Et dans un monde qui tourne déjà à un tel régime qu’il est au bord de l’implosion, c’est exactement de ça dont on a besoin: gagner du temps pour pouvoir faire plus.
Cette réflexion m’a particulièrement intéressée puisque je crois qu’on touche ici un des symboles clés de l’imaginaire dans lequel baigne l’IA: celui de l’homme augmenté. Ce mythe décrit un humain émancipé de ses limites physiques et cognitives, rendu capable, par la machine, d’embrasser une autonomie complète et de démultiplier ses capacités. Si l’on peut parler de mythe, c’est que les humains sont déjà augmentés de bien des manières, sans qu’aucun problème éthique ne contrevienne : les lunettes, les greffes ou encore les prothèses sont déjà des dispositifs visant le dépassement des limites biologiques que chaque individu peut rencontrer. Pour autant, là où la promesse de l’augmentation soulève de nombreuses questions, c’est lorsqu’elle taquine le doux rêve d’enfin être débarrassé de nos enveloppes charnelles. Et là, c’est tout un autre monde qui se découvre, peuplé de conscience téléchargeable, de vie éternelle et de victoire contre la nature. Pour le débat éthique, pas besoin de chercher plus loin. Mais revenons à l’IA, dans sa promesse de performance et de gain de temps, elle se situe quelque part entre les lunettes correctives et le transhumanisme : elle augmente la version productiviste de nous-même. Ce qui importe, ça n’est donc pas la technologie en elle-même, mais le sens et l’usage qu’on lui donne ainsi que le cadre réglementaire qu’on lui confère. Il s’agit donc d’inverser la tendance délétère que l’on semble embrasser et qui risque de nous amener à renoncer à notre propre survie et bien être pour que ces outils puissent exister, trace de l’effondrement de la raison, tel qu’Adorno et Horkheimer le craignaient déjà au milieu du XXᵉ siècle.