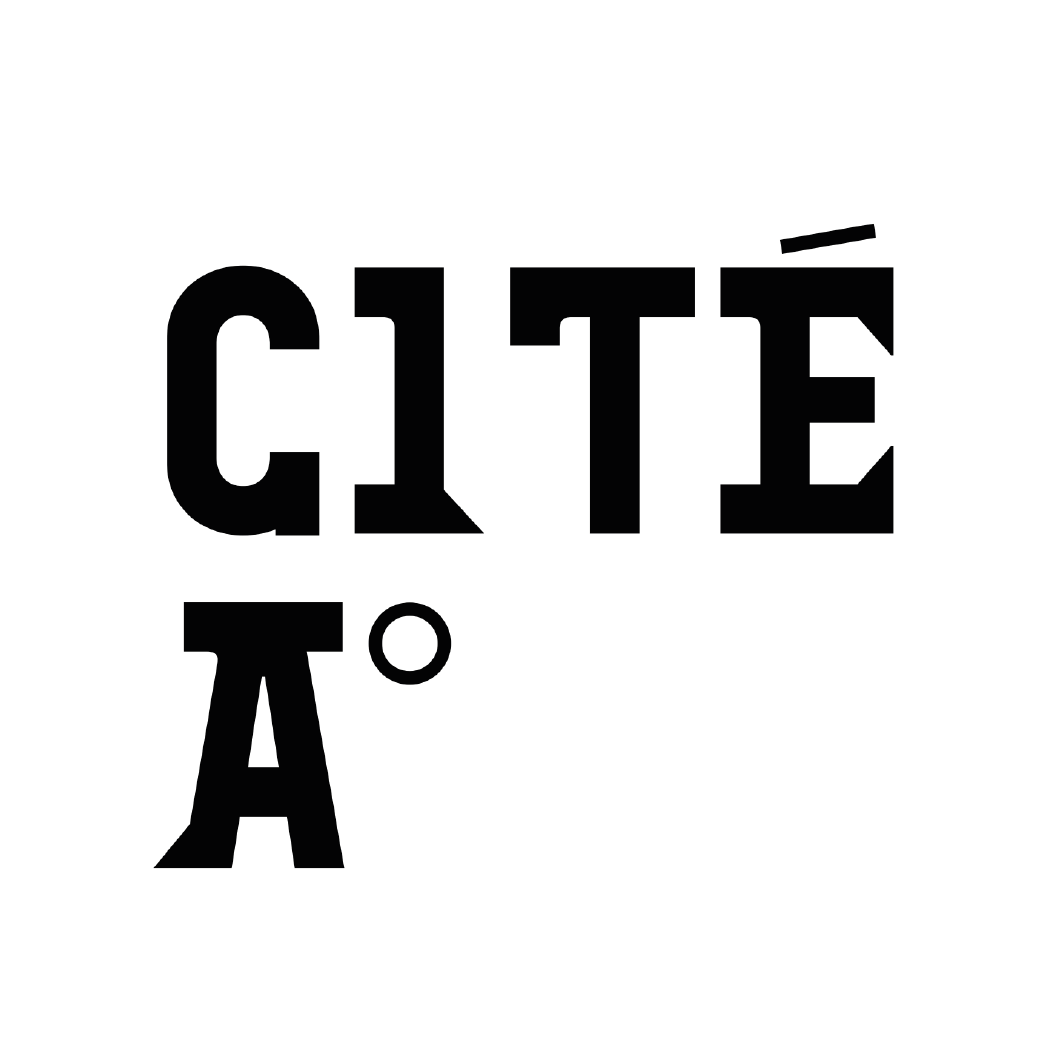C’est au cœur de la Ferme de la Croix-Rousse, écrin de nature au milieu de la ville, qu’a eu lieu, le mercredi 8 octobre, le premier volet de la séquence Botanique des marginales de l’École de la Résilience. Une journée intergénérationnelle d’ateliers multi-formats, qui a réuni de nombreux partenaires : le Collectif Animaterre (composé des Centres sociaux de la Croix-Rousse, de la Ferme de la Croix-Rousse, de la Mej (Maison d’Enfance et de la Jeunesse) et de la Ka’fête ô mômes), la Fabrique des questions simples, l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon – pratiques artistiques amateurs, l’association Des Espèces Parmi’Lyon et Cité Anthropocène.
Couplant formation botanique à destination des professionnel·les de l’animation et ateliers de mise en pratique avec enfants et seniors, cette rencontre a été l’occasion pour tous·tes d’apprécier l’inattendue biodiversité ordinaire en apprenant à regarder autrement le monde qui nous entoure. Une médiation ludique et participative ancrée dans le vivant.
Un point de départ : Botascopia
Cette initiative prend racine dans le projet Botascopia, développé par une équipe de chercheur·ses pluridisciplinaire. Entre recherche et action, il mêle botanique, informatique et sciences sociales. Botascopia est tourné vers un objectif : redimensionner le rapport au vivant dans sa reconnaissance et sa perception. A l’inverse d’autres outils numériques de reconnaissance des plantes, qui délocalisent la connaissance, l’idée ici est d’associer cette dernière à une relation empirique, du fait de la proximité de la plante.
Dans cette même perspective, Botanique des marginales invite à recentrer le regard sur son environnement proche. Cette journée aspire à la constitution d’un Botascopia dédié au lieu d’accueil de l’atelier. Privilégiant le faire, la pratique et le contact direct, l’atelier s’inscrit dans le mouvement de l’éducation populaire. Il s’agit de préférer l’expérimentation et la participation à un apprentissage strictement descendant et désincarné. La nature n’apparaît plus lointaine et idéelle, mais se relocalise dans son jardin, dans le parc public, au pied de l’immeuble.
Le contexte urbain : comment et pourquoi regarder ce qui pousse là ?
Espace d’animation pédagogique voué à sensibiliser le public à l’environnement et ses enjeux, le choix de la Ferme de la Croix Rousse pour Botanique des marginales n’a rien du hasard.
A l’heure où nos existences sont inscrites dans le béton, il est fondamental de trouver comment maintenir un lien avec le vivant. Une formation du regard a précisément vocation à répondre à cette problématique.
Une diversité d’acteur·ices
Le projet réunit différentes formes d’intelligences et de points de vue afin de déconstruire un présupposé : celui selon lequel la science aurait le monopole du savoir et de la médiation concernant le vivant. Dans l’esprit de l’École de la Résilience, il s’agit de croiser arts et sciences pour faire fleurir de nouvelles possibilités et d’étoffer le regard sur ce qui nous entoure. Cette volonté se matérialise dans le profil de nos différent·es intervenant·es.
Un casting interdisciplinaire
Eric Tannier, chercheur scientifique à l’Inria dans l’équipe Semis, est également membre de la Fabrique des Questions Simples (groupement de chercheur·es de disciplines différentes s’engageant dans une démarche collective de réflexions à l’heure de l’Anthropocène) ainsi que du projet Botascopia. Sa posture scientifique, inscrite dans l’observation et la localisation du lien entre humains et le reste du vivant, apporte une nuance face à une science normative, descendante, qui ne laisse pas place à l’exploration personnelle.

Thierry Boutonnier, artiste arboricole, est diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon (ENSBA). Attaché à faire se rencontrer l’art et le vivant, il situe le projet de Botanique des marginales dans une approche culturelle d’appropriation du milieu, qui laisse place à davantage d’expression et de participation. L’ENSBA est par ailleurs partenaire de cet atelier, au travers des Pratiques Artistiques Amateurs (PAA), ancrant plus profondément le projet dans une collusion entre pratiques scientifiques et artistiques.

L’association Des Espèces Parmi’Lyon, spécialisée dans la sensibilisation et dans l’expertise naturaliste, apporte quant à elle un volet explicatif sur la biodiversité en milieu urbain. Son point de vue pédagogique permet de fournir une initiation scientifique à son public.

Un croisement des publics
Botanique des marginales repose également sur la pluralité de ses invité·es. Durant la matinée, des animateur·ices issu·es de différentes structures du Collectif Animaterre ont ainsi pu croiser leurs propres connaissances et expertises de l’animation avec les explications des intervenant·es.
L’après-midi, ce sont les publics mêmes de ces organismes qui ont rejoint la Ferme. Les enfants du périscolaire se sont retrouvés aux côtés d’amateur·ices des PAA et de groupes seniors, affiliés notamment aux Centres Sociaux de la Croix-Rousse. Ce moment a permis de véritables rencontres et interactions intergénérationnelles. Le mélange des regards sur le vivant, partagé entre personnes de différentes générations, engendre une redéfinition mutuelle des points de vue sur la biodiversité locale, ainsi qu’un apprentissage réciproque, pratique et empirique.
Un passage par la pratique : une diversité d’expériences proposées
Une matinée de formation
La matinée a été l’occasion de former les animateur·ices sur les pratiques à adopter afin de faire interagir les enfants avec le milieu botanique. Ce temps a été mené par trois membres de l’association Des Espèces Parmi’Lyon et par Thierry Boutonnier. Ces derniers ont d’abord insisté sur les précautions à suivre durant les animations afin de ne pas peser sur des milieux fragiles comme celui de la mare de la Ferme de la Croix Rousse. L’expérience de la biodiversité ne doit pas se faire au détriment de cette dernière. Ielles ont ensuite souligné l’importance du vocabulaire : le nom de certaines plantes se révèle parfois être l’occasion de mobiliser les imaginaires (en évoquant la guimauve pour parler de mauve par exemple, ou en comparant les noms des plantes à ceux des Pokémons) et d’ancrer ainsi des connaissances nouvelles dans l’univers de sens des enfants.
Enfin, l’intérêt de la dimension pratique – voire même physique – a été rappelée. En engageant le corps et pas seulement l’esprit, en proposant une expérience qui mobilise les sens et qui procure de la joie, génère des endorphines, on incarne les apprentissages et on augmente la capacité mémorielle des enfants. Thierry Boutonnier a proposé dans ce sens un exercice de yoga de l’arbre à reproduire avec les groupes périscolaires. L’intérêt d’une telle démarche, moins professorale, est de former un public particulier (en l’occurrence, la petite enfance) aux liens avec son environnement, afin de contrer l’indifférence que le contexte urbain risque de produire.
Les animateur·ices ont ainsi pu repartir de ce temps de formation avec de nouvelles clés à donner aux enfants dans leur contact avec les écosystèmes, forts d’un partage de connaissances horizontal avec les intervenant·es, mais également entre elleux.
Les ateliers botaniques : l’expérience comme mot d’ordre
Durant l’après-midi se sont déroulés trois ateliers complémentaires. Les groupes intergénérationnels ont été répartis afin de pouvoir tester, à tour de rôle, les différentes méthodes proposées.
Un premier atelier, animé par Victor de Des Espèces Parmi’Lyon, a amené par le jeu et la mobilisation des imaginaires l’expérience de la biodiversité. Victor a proposé une rencontre sensible avec l’écosystème local, mobilisant à tour de rôle le toucher puis le regard. Il a ainsi invité les participant·es à effleurer l’écorce d’un arbre, yeux fermés, puis à retrouver, yeux rouverts, le sujet en question. Ludique, cette expérience a pour vocation d’engager un nouveau rapport à la biodiversité, d’un regard passif à une réelle relation avec celle-ci. Une relation d’attention, par la restriction du sens le plus utilisé (la vue) afin de créer un nouveau lien, qui rapproche davantage puisqu’il engage un contact direct du corps avec le vivant.
Les deux autres ateliers visaient à créer des inventaires botaniques participatifs par la cueillette de plantes dans des secteurs réduits et bien délimités, entre un et deux mètres carrés. L’un d’eux, mené par Des Espèces Parmi Lyon, a initié le public à la méthode scientifique. Celle-ci consiste à nommer la plante et apprendre à la reconnaître, afin d’aller à sa recherche dans la zone de prélèvement. Cette démarche empirique permet d’associer la pratique à l’apprentissage et de préférer connaissance de la plante aux connaissances sur la plante.
Dans un second atelier d’inventaire, Thierry Boutonnier a proposé une méthode d’arrachage libre en apparence beaucoup moins cadrée. Le groupe s’est rendu sur le secteur délimité, a arraché des plantes, sans contrainte. Puis chacun·e a été invité·e à créer une planche d’herbier légendée qui raconte la rencontre qu’iel en a faite. Par la suite, Thierry a ajouté une consigne selon laquelle une espèce déjà arrachée ne pouvait pas être de nouveau cueillie. Redoublant d’attention, chacun·e est retourné vers l’aire de recherche pour trouver une nouvelle plante.
Cet atelier a permis de travailler sur les interactions humain·es/plantes et de développer curiosité et observation. La contrainte de non-cueillette d’une espèce déjà trouvée, qui plus est sur un espace de taille réduite, est une invitation à prendre le temps, à bien regarder, et, l’air de rien, à faire l’expérience concrète de la diversité du vivant. Dans un contexte d’instantanéité de l’information, où l’usage d’outils numériques permet d’accéder à un résultat sans vraiment regarder ce que l’on questionne, l’atelier a au contraire permis de mettre en avant la démarche inspirée de Botascopia. Secondaire, ce résultat (c’est-à-dire l’accès au nom de la plante) n’est qu’un prétexte pour engager un réel chemin d’observation et de compréhension de la plante.
Ces trois ateliers démontrent ainsi qu’en réinstaurant du temps, du sensible et de l’attention dans notre pratique, nous rétablissons plus aisément une relation locale et située à la biodiversité, ainsi que des connaissances plus concrètes et précises à son propos.
Plus qu’une éducation à la botanique, cette journée s’est révélée être une pédagogie de l’observation, de l’éthique de l’attention dans une culture du care. Comme l’écrit la philosophe Sandra Laugier dans Care et perception (2011),
“L’absence d’attention et de care, le manque de perception de l’importance font « manquer l’aventure »”
En formant le regard par l’expérience, nous renouons un lien plus fort avec le vivant local afin de ne pas passer à côté de ce qu’il représente vraiment : notre propre milieu de vie.
Un moment convivial d’expérience du vivant, qui n’est encore qu’à l’état de germe. Les herbiers constitués feront bientôt l’objet d’ateliers artistiques dans les différentes structures. Un nouveau croisement entre arts et sciences, preuve que ces deux milieux, loin d’être opposés, ont tout à apprendre dans leur rencontre.